- Cuisine
- Saveurs
- François Simon
- Les savoureux paradoxes de la gastronomie parisienne
Les savoureux paradoxes de la gastronomie parisienne
Les restaurants de la capitale française sont adulés partout sur la planète. Un grand auteur et critique culinaire revient sur ce qui, à ses yeux, explique l’influence profonde que la Ville lumière continue d’exercer sur l’univers de la gastronomie.

Les restaurants de la capitale française sont adulés partout sur la planète. Un grand auteur et critique culinaire revient sur ce qui, à ses yeux, explique l’influence profonde que la Ville lumière continue d’exercer sur l’univers de la gastronomie.
POURQUOI LA GASTRONOMIE PARISIENNE EST-ELLE SI ATTACHANTE ?
Parce qu’elle est illisible, exaspérante et fidèle. Illisible, parce qu’elle va à droite, à gauche, s’oublie puis redémarre. Exaspérante, parce qu’elle passe son temps à se contredire, à prôner la modernité, puis la laisse dans le fossé. C’est une girouette. Chanter les produits, mais aussi les asservir, les dérouter, les réduire en mousse, purée, filaments. Fidèle, aussi, parce qu’elle ne peut s’empêcher de se retourner sur son passé, fût-il fantasmé. Fût-il même réinventé dans ces fameux plats de grands-mères, que l’on appelle à la rescousse histoire de justifier le retour des tomates farcies et du poulet rôti. Fidèle à ses sources, et c’est tout à son honneur. C’est sans doute ici toute son ambivalence qui fait son élégance : ne pas avoir à tuer le père (ou la mère) pour exister. C’est pour son attachement à ses racines, à ses origines, que la cuisine parisienne est si touchante. Elle est toujours amoureuse des gestes d’antan, des flambages, des décantations. Le fait même de déposer une tasse, une soucoupe appartient à une gestuelle millénaire : juste la pincer, la déposer avec une précision aéronautique. En cela, les tables parisiennes restent uniques, courues de par le monde.

Maison Rostang
Maison Rostang, la fidélité à soi-même
Le climat du restaurant Michel Rostang, créé en 1978, est immuable. Les boiseries, la bande-son pianotée, les éclairages, le service respectueux rappellent une époque où la cuisine prenait ses aises et son temps. C’est sans doute ce que l’on vient chercher dans ce restaurant doublement étoilé. Certes, le nom a changé – place à la Maison Rostang –, le chef également : voici Nicolas Beaumann (ex-Yannick Alléno au Meurice) apportant sa touche de modernité avec des sauces troussées, des clins d’oeil minimalistes, sans toutefois bouleverser les grands classiques de la maison. Le canard au sang fait partie de ces moments d’anthologie de la cuisine parisienne avec ce même rituel : découpe sur le chariot, chauffe-plat pour la sauce et surtout, la carcasse passant dans la presse en argent dont on tourne savamment la roue crénelée. Caves puissantes aux nombreux couplets (50 000 bouteilles) et d’impressionnants refrains : 1 300 références.
Lucas Carton : toujours renaître
Ce restaurant installé face à la Madeleine peut être considéré comme l’un des repères majeurs de la gastronomie parisienne. De tout temps, la ville s’y pressait pour admirer les boiseries de Majorelle, mais également une cuisine couronnée très vite de trois étoiles Michelin. L’arrivée d’Alain Senderens (1985) est un moment fort, marqué par l’instauration des associations mets et vins, avec le professeur Jacques Puisais. En 2005, sentant le vent tourner, le chef restitue les trois étoiles, retire les nappes à l’étonnement général pour installer les plateaux en Corian imaginés par le designer Noé Duchaufour. L’arrivée de Hugo Bourny, surdoué jaillissant comme une flèche des tables de Marsan, Maison Pic et La Vague d’Or, incarne une nouvelle approche de la cuisine avec des assiettes fortes tels ces légumes racines présentés avec un sabayon verjus et beurre fumé. Il y a dans ce plat la reconstitution d’un univers végétal inattendu et imagé (le fumé) rivalisant avec le plat suivant : la lotte marinée, puis fumée et maturée, carotte maraîchère et kombucha. Outre le graphisme avenant, la force de la cuisine d’Hugo Bourny est son intelligence des produits, qu’il va chercher dans ses seconds rideaux.

Lucas Carton © Mickaël Bandassak
David Toutain, l’explosion douce
Aux avant-postes de la cuisine, il y a toujours des ferrailleurs qui se lèvent aux aurores pour suivre le fil de la rosée. Ils guettent les saveurs de la pénombre, quadrillent les clairières des produits. David Toutain appartient à cette famille des inlassables, reconstruisant sa cuisine à chaque service, la faisant facetter pour un bigorneau, un pain (Ten Belles) et son beurre salé, un pigeon de haute volée. Dans le clair-obscur d’une salle tout en verticalité gris ardoise, il remonte sans doute les yeux fermés le long chemin qui l’a conduit jusqu’ici : second d’Alain Passard à 21 ans, fils spirituel de Marc Veyrat à 25 ans, dans non pas un, mais deux de ses restaurants… Il se lance dans l’aventure d’Agapé avant de se poser ici, rue Surcouf (2013). Un repas chez David Toutain nécessite une jolie concentration, car parfois les plats murmurent (salsifis, panais, cacahuète), criquettent (couteaux, oignons, xérès), bruissent (bulots, romanesco, bergamote)… Ajoutez à cela, les associations imaginées par la sommellerie (Fabien Vullion) traversant même le mur des traditions avec un soft-pairing à base de kombuchas, extractions, maturations, infusions à froid, jus, fermentations, eaux, thés, décoctions…

David Tountain © Yves Thibault
UNE VÉRITABLE BOUSSOLE DANS LE PAYSAGE GASTRONOMIQUE FRANÇAIS.
Électrochoc au Taillevent
Véritable marqueur de la restauration française, le restaurant Le Taillevent, propriété des frères Gardinier à l’instar du Domaine Les Crayères (Relais & Châteaux, à Reims), appartient à ces institutions stoïques de la gastronomie française. Il fallait sans doute l’électrochoc pratiqué depuis son arrivée par Giuliano Sperandio dans ce qui fut l’ancien hôtel particulier du duc de Morny (1852), pour redonner du lustre à l’institution parisienne. Voici donc à présent des plats debout, tonitruants, tutoyant les gibiers, truffe, homard, turbot et autres sommités, tout en gardant un oeil dans le rétroviseur : langoustines-boudin tradition Taillevent ; homard bleu, shiitaké, sauce au poivre, mayonnaise au café… Mais là où Le Taillevent fait la différence, c’est par le prolongement du geste dans la salle. Flambage et découpe sont prodigués par une équipe dirigée par Baudouin Arnould, devançant les moindres désirs de la clientèle. Cette dernière reste fidèle à l’établissement pour ce maillage subtil entre cuisine et service, d’autant qu’une cave exceptionnelle harmonise l’ensemble et procure un sentiment rare, celui d’une institution épousant son époque.

Le Taillevent © Mickaël Bandassak
Frédéric Anton, attendre pour oser
Lorsqu’on est à la tête de deux établissements aussi parisiens que Le Pré Catelan (trois étoiles au Guide Michelin) et Le Jules Verne (une étoile), la tentation est de ne pas faire trop de vagues et de s’en tenir à une feuille de route classique et sans embûches. « C’est ce que je pensais au début, exprime Frédéric Anton. Lorsque je suis arrivé au Pré Catelan, il y a 26 ans, je n’osais pas bouger une oreille et souhaitais respecter les attentes d’une clientèle très parisienne et classique. Et puis, les années passant, je me suis dit qu’il fallait assumer son risque. Et alors seulement, je me suis lancé. Ainsi, dernièrement, j’ai proposé un burger d’asperges avec ses sauces. Cela a fait un tabac sur les réseaux sociaux ! Alors qu’au Jules Verne, la même asperge, je l’aborde avec plus de sagesse. Elle est ainsi proposée en pointes d’asperges, un flan d’asperges et une petite mousse d’oignons bien goûteuse. » Frédéric Anton, dont la concession du Pré Catelan vient d’être renouvelée pour 18 ans, bichonne la nouvelle carte d’une deuxième adresse sur le site, la Ferme du Pré Catelan.

La Ferme du Pré Catelan

Le Jules Verne © Mickaël Bandassak
LA SCÈNE S’EXPRIME À LA FAÇON D’UNE TROUPE DE THÉÂTRE JONGLANT ENTRE RAFFINEMENT, SIMPLICITÉ ET ÉNERGIE.
La Scène réinterprète le répertoire
Entre Élysée et Champs-Élysées, il suffit de descendre quelques marches pour rejoindre un antre mordoré, temple de la cuisine de Stéphanie Le Quellec, vedette de la scène gastronomique grâce à sa présence télévisuelle et surtout à son passage au restaurant du Prince de Galles, qu’elle a auréolé d’une étoile Michelin. « Désacraliser » la grande gastronomie, comme elle le souhaite, n’est pas sans risques. Car si souvent certains s’y réfugient, s’en affranchir suppose du toupet et surtout, un sacré savoir-faire. Depuis sa cuisine ouverte, la cheffe envoie des compositions balançant entre Bretagne natale de son époux et Provence chère au coeur de son enfance. Le répertoire, si elle s’en libère, c’est sans doute pour mieux se rapprocher des produits ; en témoigne ce triptyque ormeaux/tripes/caviar. Il faut comprendre également La Scène comme la représentation d’une équipe soudée où facettent aussi bien la pâtisserie entraînée par Pierre Chirac, relayée par Joseph Desserprix (directeur du restaurant et MOF 2022) ou encore la sommellerie, avec Matthias Meynard. La Scène s’exprime comme une troupe de théâtre jonglant entre raffinement, simplicité et énergie.

La Scène © Mickaël Bandassak
Pierre Gagnaire, le doute comme un sceptre
Lorsqu’il arriva à Paris, en 1996, Pierre Gagnaire s’installa dans un restaurant italien tout tendu de tissus écossais. Sa mésaventure à Saint-Étienne, où il avait décroché trois étoiles et déposé le bilan, faisait de lui une énigme. Et pourtant, il ne lui fallut que quelques années pour retrouver ses trois macarons et rappeler à tous que son talent s’était renforcé au fil des épreuves. Sa cuisine reste souvent un mystère parce qu’elle vient du doute. Lorsque Pierre Gagnaire voit un produit (un turbot, une seiche, un pigeon…), il s’embarque dans une approche multiple, parfois complexe, pour trouver le son juste. C’est du reste aux clients d’entrer dans la danse, d’aller chercher avec lui son expression. La cuisine de Pierre Gagnaire appartient à ces partitions actives, jazzy, où souvent le plaisir vient d’un contretemps, comme la caisse claire dans un trio de jazz. Cuisine du perpétuel mouvement, elle s’appuie sur un axiome limpide : « Donner et recevoir ». Le décor en tartan a bien sûr disparu et depuis peu, l’architecte argentin Marcelo Joulia s’est attaché à donner à la salle de la rue Balzac une dimension à la fois poétique et onirique.

Pierre Gagnaire
Le Grand Véfour, immuable
Traverser les siècles, perdurer, c’est sans doute la vocation de ce restaurant mythique, né en 1784. C’était alors le Café de Chartres. Il devint Grand Véfour tout simplement parce que Jean Véfour en fit l’acquisition en 1820. Mais ce n’est qu’en 1948, avec Raymond Oliver, que l’adresse prit un essor spectaculaire. Cuisinier de caractère, il fut le premier chef télévisuel. Mais la légende s’était déjà installée sur les banquettes pourpres du lieu. Tous les grands, les magnifiques, vinrent un jour s’y attabler. Des plaques de cuivre discrètes rappellent leur passage : Bonaparte et Joséphine, Hugo, Balzac, Colette, Cocteau, Guitry et Malraux. Aujourd’hui, le chef Guy Martin, après avoir glané les étoiles, a compris que les temps changeaient. Il fallait donc s’adapter. Ce qu’il fit en mai 2021, avec une grande terrasse sous les arcades. Le Café de Chartres était de retour. La cuisine a suivi cette mutation en offrant non seulement des petits déjeuners, mais aussi des menus fort abordables avec, toujours, la touche gastronomique. Une chose, toutefois, n’a pas changé. Elle fait le charme irrésistible du Grand Véfour : c’est la lumière, au déjeuner, filtrant à travers les verres dépolis.
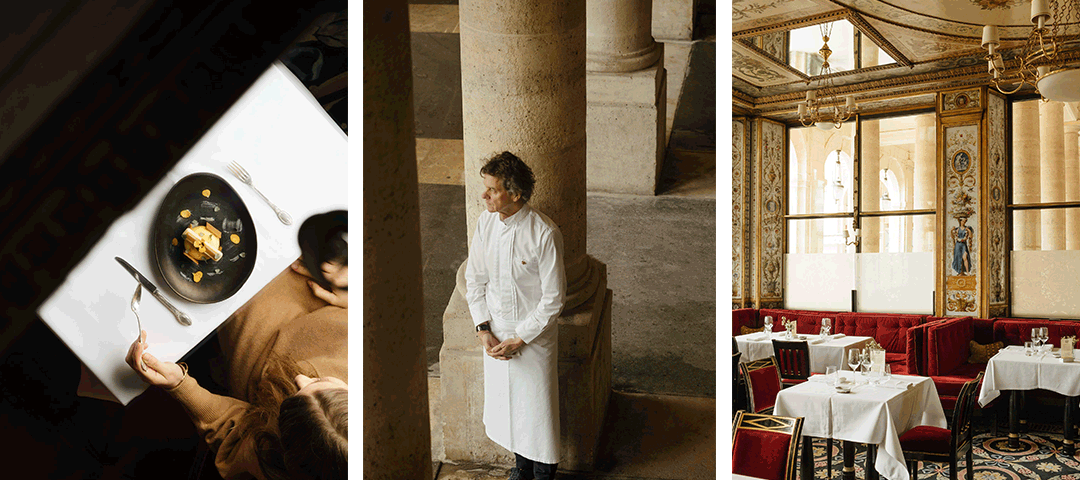
Le Grand Véfour © Mickaël Bandassak


